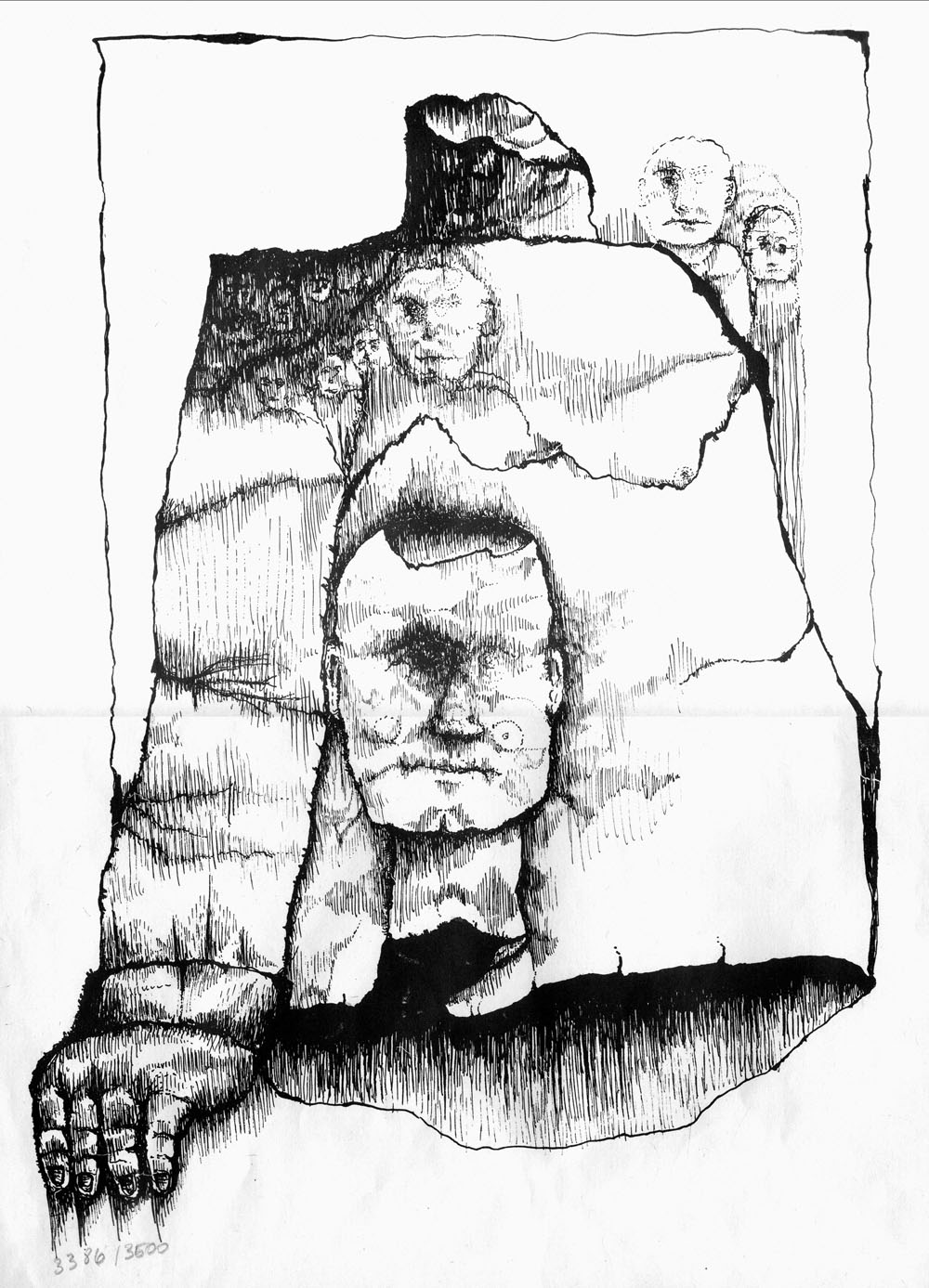Maxime Forester (University of Michigan)
Tess of the d’Ubervilles, comme tant d’autres romans victoriens par ailleurs, pose crûment la question de la violence sexuelle dans un contexte où la politique des affects diffère radicalement de celui que connaît aujourd’hui l’Amérique de Nord après les avancées du féminisme anti-sexe dans les années 70 et 80. Le présent article esquisse la problématique inhérente à ce qui pourrait être une épistémologie du viol mise en branle dans le chef d’œuvre de Thomas Hardy. Entre dogmatisme et aporie, la question du viol butte sur une approche constructiviste des pratiques sexuelles qui interdit de calquer sur la société victorienne les critères que nous appliquons dans la société nord-américaine contemporaine. Il en serait de même, par exemple, pour Les confessions de Lady Nijo, récit médiéval japonais dans lequel une courtisane met en scène son dépucelage par l’Empereur alors qu’elle était à peine pubère. Textes, contextes, prétextes, autant de paramètres qui brouillent l’appréciation éthique d’une esthétique de la violence sexuelle. Sans compter, mais c’est ici ouvrir un autre chantier qui nous renvoie cependant à la notion de consentement, qu’il faudrait aussi interroger la littérature SM sur la théâtralisation de la violence et la cartographie d’un corps en proie à la souffrance érogène. On aura compris, à la lecture de cet article, qu’utiliser le féminisme anti-sexe d’une Dworkin ou d’une MacKinnon comme seule grille de lecture plomberait l’exégèse de la plupart des textes où il est question de violence sexuelle. Les écrits notamment de Gayle Rubin, Pat Califia et Dorothy Alison ont permis de donner au féminisme pro-sexe la possibilité d’aérer et enrichir considérablement la critique littéraire de la sexualité en général et du viol en particulier.
Tess of the d’Ubervilles, comme tant d’autres romans victoriens par ailleurs, pose crûment la question de la violence sexuelle dans un contexte où la politique des affects diffère radicalement de celui que connaît aujourd’hui l’Amérique de Nord après les avancées du féminisme anti-sexe dans les années 70 et 80. Le présent article esquisse la problématique inhérente à ce qui pourrait être une épistémologie du viol mise en branle dans le chef d’œuvre de Thomas Hardy. Entre dogmatisme et aporie, la question du viol butte sur une approche constructiviste des pratiques sexuelles qui interdit de calquer sur la société victorienne les critères que nous appliquons dans la société nord-américaine contemporaine. Il en serait de même, par exemple, pour Les confessions de Lady Nijo, récit médiéval japonais dans lequel une courtisane met en scène son dépucelage par l’Empereur alors qu’elle était à peine pubère. Textes, contextes, prétextes, autant de paramètres qui brouillent l’appréciation éthique d’une esthétique de la violence sexuelle. Sans compter, mais c’est ici ouvrir un autre chantier qui nous renvoie cependant à la notion de consentement, qu’il faudrait aussi interroger la littérature SM sur la théâtralisation de la violence et la cartographie d’un corps en proie à la souffrance érogène. On aura compris, à la lecture de cet article, qu’utiliser le féminisme anti-sexe d’une Dworkin ou d’une MacKinnon comme seule grille de lecture plomberait l’exégèse de la plupart des textes où il est question de violence sexuelle. Les écrits notamment de Gayle Rubin, Pat Califia et Dorothy Alison ont permis de donner au féminisme pro-sexe la possibilité d’aérer et enrichir considérablement la critique littéraire de la sexualité en général et du viol en particulier.